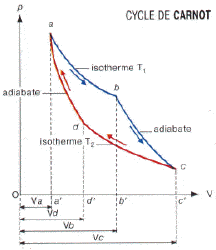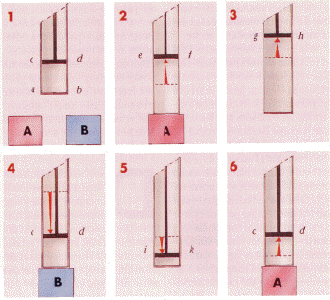Carnot Nicolas Sadi
Carnot Nicolas Sadi par Brugère Charlotte (2nde 9 - janvier 2006)

Paris 1er juin 1796 - 24 août 1832.
Fils aîné de Lazare Carnot, frère d’Hippolyte. Savant reconnu comme père de la Thermodynamique.
Élève au lycée Charlemagne, il fut reçu vingt-quatrième en 1812, à l’age de seize ans,
à l’École Polytechnique, dont il sortit 1er dans l’Artillerie. Il combattit avec le bataillon
des polytechniciens lors de la défense du Fort de Vincennes contre les alliés en 1814.
Candidat au concours de l’état-major en 1819, il fut reçu avec le grade de lieutenant puis quitta
l’armée avec le grade de capitaine du génie en 1828 pour venir se fixer à Paris. Il y mourut du
choléra à l’âge de trente-six ans, sans postérité.
Sadi Carnot est connu comme le fondateur de la thermodynamique. Il publia à ses frais en 1824 ses
Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance.
C’est dans cette oeuvre de moins de cent vingt pages et tirée seulement à six cents exemplaires
qu’il fonda ce que nous appelons aujourd’hui le second principe de la thermodynamique ou principe de Carnot.
Quant au premier principe, celui de la conservation de l’énergie, il le découvrit également avant la fin de
sa vie, comme l’ont montré ses papiers posthumes, publiés en 1878.
Cycle de Carnot
Cycle thermodynamique ditherme réversible, constitué de deux transformations
isothermes et de deux transformations adiabatiques.
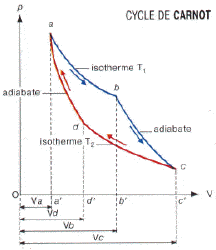
Machine de Carnot
Machine thermique idéale dans laquelle une masse de fluide effectue des cycles
de Carnot. Une telle machine peu servir de modèle pour un moteur thermique ou une machine frigorifique.
Une "animation" facilite la compréhension du cycle :
De l'air à la température T1 est contenu dans un cylindre, fermé par un piston étanche (position de départ : cd).
Une source chaude A, à la température T1, et une source froide B, à la température T2, constituent des
réservoirs infinis de chaleur.
Le cylindre est mis en contact avec A : du calorique passe de la source à l'air, qui se détend librement
et pousse le piston jusqu'en ef.
Le cylindre est isolé de toute source de chaleur. Pendant sa détente "adiabatique", l'air pousse le piston
jusqu'à gh : sa température chute jusqu'à T2.
Le cylindre, qui est alors à la température T2, est mis en contact avec la source B, à température identique.
Un expérimentateur "virtuel" pousse le piston vers le bas : cette compression "isotherme" l'amène à la
position cd. Du calorique passe de l'air à la source B.
Le cylindre est de nouveau isolé de l'extérieur. L'expérimentateur virtuel continue à pousser le piston
jusqu'à la position ik, de telle manière que la température de l'air atteigne T1.
Le cylindre est mis en contact avec A, qui délivre de la chaleur à l'air : il se détend jusqu'à que le
piston reprenne sa position initiale cd.
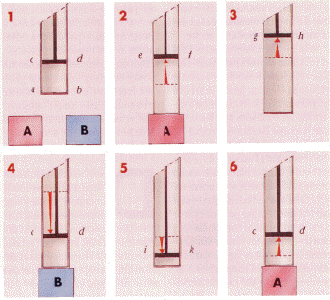
Principe de Carnot
Nom sous lequel on désigne le deuxième principe de la thermodynamique.
C'est en effet Carnot qui a formulé le premier (1824) l'impossibilité de réaliser un moteur thermique
fonctionnant avec une seule source de chaleur.
Théorème de Carnot
Théorème relatif au rendement des moteurs thermiques dithermes. Dans un
moteur ditherme, la source chaude (chaudière) fournit au cours d'un cycle une quantité de chaleur Q1
dont une partie W est transformée en travail et l'autre restituée sous forme de chaleur à la source
froide (condenseur). On appelle rendement du moteur le rapport:

Le théorème de Carnot peut s'exprimer ainsi: " le rendement d'un moteur
ditherme est maximal lorsque celui-ci fonctionne de façon réversible; dans ce cas il ne dépend que des
températures des deux sources." Lord Kelvin a défini l'échelle absolue de température en
écrivant:

où T1 et T2 sont les températures absolues des sources chaude et froide.
Retour