
Olaüs Roëmer(1644-1710)
par Fleur Giancarli - 2nde 4 - janvier 2006.
Roemer , astronome né le 25 septembre 1644, à Copenhague (ou à Aarhuus?), m. de la pierre, le 19 septembre 1710, à soixante-six ans. Il fut amené en France en 1672 par Picard qui l'avait vu et apprécié à Uraniborg fut placé près du Dauphin pour lui enseigner les mathématiques, et entra dès 1674 à l'Académie des sciences. Ce fut pendant son séjour à Paris, en 1676, que Römer fit cette grande découverte que la lumière a un mouvement successif (autrement dit qu'elle ne se propage pas intantannément, et qu'on peut lui donner une vitesse), et qu'elle met 7 à 8 minutes pour parcourir la distance du Soleil à la Terre.
Sa théorie, déduite de ses observations des éclipses du 1er satellite de Jupiter, était contraire aux idées reçues, et il ne parvint à la faire triompher qu'en la défendant énergiquement, car son adversaire était D. Cassini, qui aussi avait eu, mais ensuite abandonné, l'idée du mouvement de la lumière.
Découverte de la vitesse de la lumiere.
Des observations du premier satellite de Jupiter, faites par Roëmer et par Dominique Cassini, indiquèrent une inégalité que les deux savants astronomes crurent un moment pouvoir attribuer à la propagation successive de la lumière. Cassini rejeta bientôt cette idée si juste. Roëmer en maintint l'exactitude, et attacha ainsi son nom à une des plus grandes découvertes dont l'astronomie moderne puisse se glorifier.

Roëmer
On a fait remarquer avec raison, qu'après l'idée si heureuse d'attribuer les différences qu'on observe entre les retours du premier satellite de Jupiter, aux limites u cône d'ombre pendant la première et pendant la seconde quadrature de la planète, et la propagation successive de la lumière, Roëmer, chose inexplicable, négligea de prouver qu'on trouverait, dans la même hypothèse, l'explication des inégalités présentées par les trois autres satellites.
On pourrait s'étonner avec autant de raison qu'il n'ait pas essayé d'évaluer plus exactement qu'il ne l'a fait la vitesse de la lumière. Horrebow, l'élève de prédilection de Roëmer et son admirateur sans réserve, fixe à 14 mn 10 s au lieu de 8 m 13 s le temps que la lumière emploie à franchir l'intervalle qui sépare le Soleil de la Terre. (Arago, c. 1850).
Roëmer qui avait été témoin à Paris des difficultés de faire mouvoir dans le plan du méridien la lunette d'un quart de cercle mural, c'est-à-dire une lunette pirouettant sur un axe très court et assujettie à s'appliquer sans cesse sur un limbe imparfaitement dressé, imagina et construisit en 1700 la lunette méridienne. Cet instrument, (connu sous le nom d 'instrument des passages) qu'on voit aujourd'hui dans tous les observatoires, est donc de l'invention de l'astronome danois.
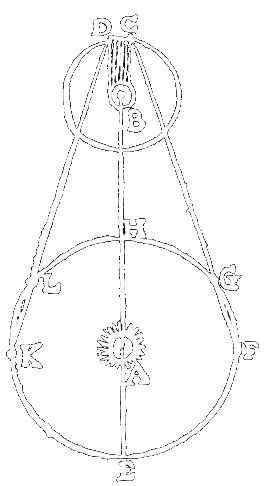
On lui est aussi redevable d'un micromètre ingénieux dont on faisait souvent usage pour l'observation des éclipses vers la fin du XVIIe siècle. Avec ce micromètre, on pouvait augmenter ou diminuer l'image du Soleil ou celle de la Lune, de manière qu'elles fussent exactement renfermées entre deux fils situés près de l'oculaire.
Roëmer quitta la France comme Huygens à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Frédéric IV le reçut avec une grande faveur, et lui conféra en 1681 le titre de professeur royal. Il devint directeur des monnaies, inspecteur des arsenaux et des ports, et enfin conseiller d'État, en 1707, et premier magistrat de Copenhague, emploi qu'il remplit pendant cinq années à la grande satisfaction du souverain et du public.
Condorcet fait à cette occasion les réflexions suivantes : "Frédéric IV était heureusement supérieur à ce préjugé si commun dans les cours, que les savants sont incapables des places d'administration, comme si l'habitude de chercher la vérité ne pouvait pas tenir lieu de la routine qui s'acquiert dans les emplois subalternes. Si pourtant l'on prend l'esprit d'intrigue pour celui des affaires, et l'art de tromper ou d'opprimer les hommes pour celui de les gouverner, on a raison de croire que les savants n'y sont pas propres, et qu'une âme qui s'est longtemps nourrie de l'amour de la vérité et de la gloire, ne peut guère sentir la nécessité ni prendre l'habitude de ce mélange de fausseté et de bassesse qu'on décore du nom d'habileté.